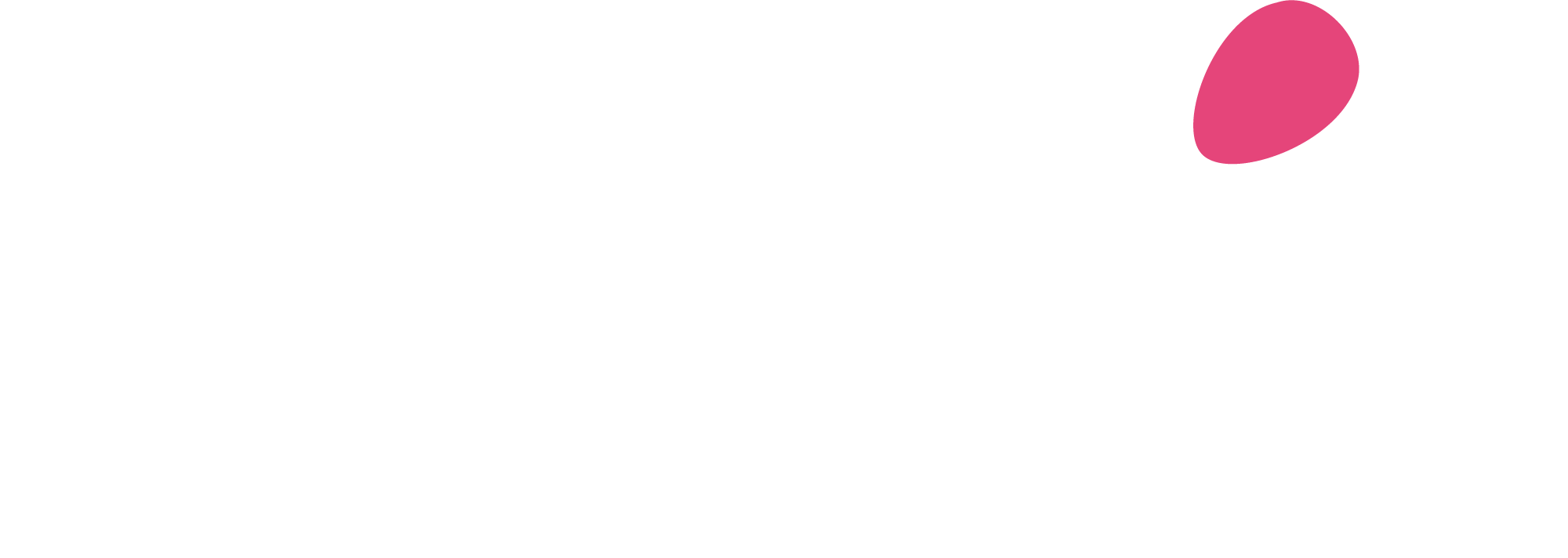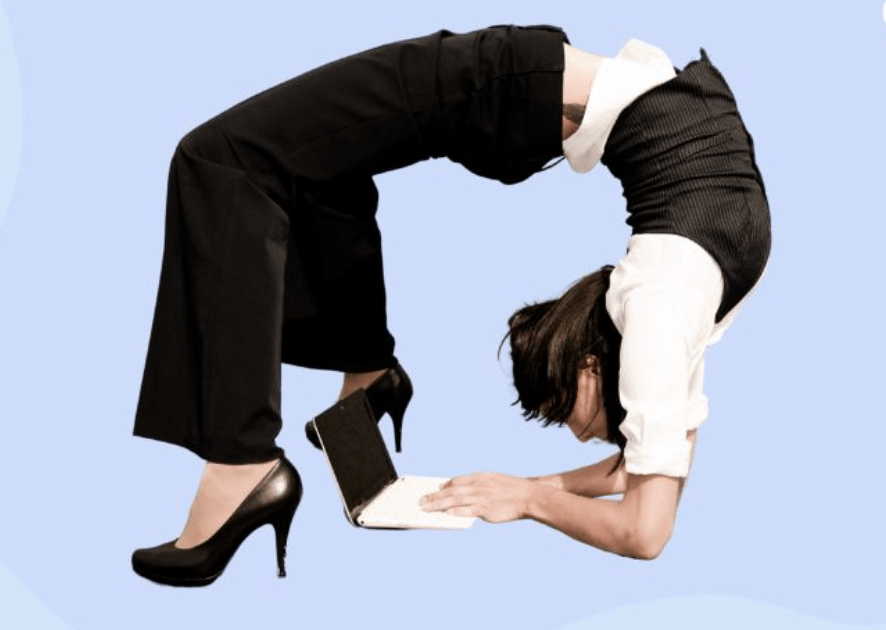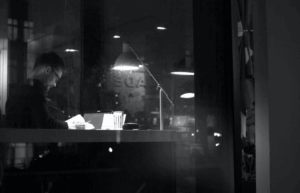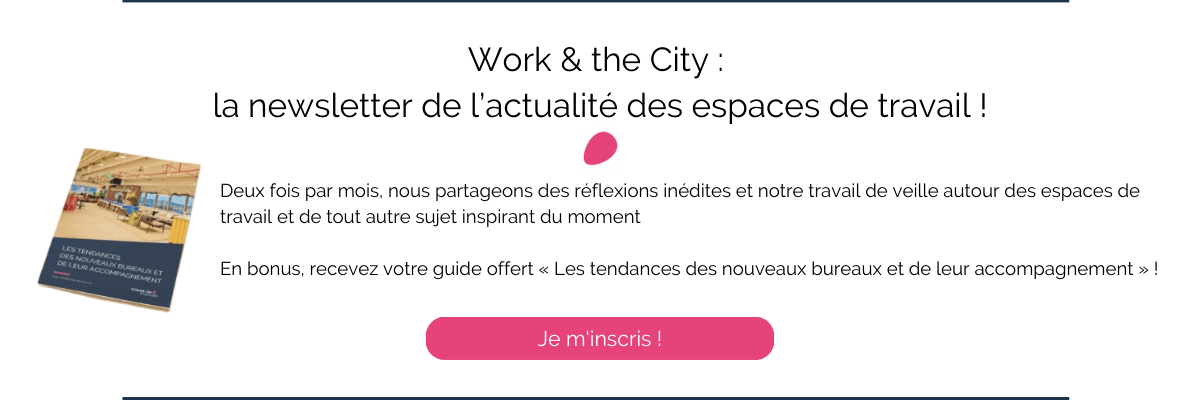Avec la crise du Covid-19, le télétravail s’est généralisé, imposant dans son sillage une nouvelle organisation du temps de travail. Le travail flexible s’est imposé comme une nouvelle norme dans de nombreux secteurs. Pouvoir travailler à distance, choisir ses horaires ou son lieu de travail semble offrir une liberté sans précédent.
Le rapport de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) souligne que cette transition a aussi fait émerger une autre forme de flexibilité : le travail « asynchrone ».
Concrètement, cela signifie que chacun peut fournir son travail selon un minimum de contrainte horaires ou spatiales. Résultat : les journées s’étirent, les rythmes se décalent. Derrière cette apparente autonomie, se cachent des risques sur notre santé, nos rythmes de vie et notre organisation collective. Le travail flexible est-il en train de désynchroniser la société ?
50 shades of flex : que recouvre vraiment le travail flexible ?
Le mot « flexibilité » est devenu omniprésent : offres d’emploi, politiques RH, discours managériaux. Mais que signifie-t-il concrètement ? Derrière ce mot-valise se cachent plusieurs dimensions, qui n’ont pas les mêmes implications pour les salariés… ni les mêmes conditions de réussite.
Flexibilité horaire
C’est la possibilité de choisir quand on travaille. Cela peut se traduire par :
- des horaires libres selon sa productivité,
- la semaine de 4 jours,
- le respect du droit à la déconnexion.
Mais cela n’est viable que si l’entreprise fait confiance à ses collaborateurs. Sans cette confiance, la flexibilité se transforme vite en surveillance ou en surcharge.
Flexibilité spatiale
Travailler où l’on veut : au bureau, à domicile, en espace de coworking ou dans un tiers-lieu. Avec des formes comme le flex office ou l’activity-based working, l’espace de travail devient modulable selon les tâches.
Cela implique de repousser les murs de l’organisation. Cette flexibilité nécessite :
- des espaces bien pensés,
- des outils numériques adaptés,
- et des règles collectives claires.
C. Rabineau
Changement culturel
Le travail flexible ne se résume pas à une liste d’avantages. Il implique un changement de culture profonde, fondé sur :
- la clarté des règles,
- une équité réelle entre les collaborateurs,
- et surtout, une relation de confiance entre salariés et encadrants.
L’émergence des horaires décalés et le risque de surcharge
Cette flexibilité s’accompagne toutefois d’un phénomène préoccupant : la montée des horaires décalés. En France, plus d’un tiers des salariés travaillent déjà selon ces horaires dits « atypiques », qui incluent le travail tôt le matin, tard le soir, voire la nuit ou le week-end.
La DARES avait déjà tiré la sonnette d’alarme dès 2019 : les cadres effectuant plus de deux jours de télétravail hebdomadaire sont aussi ceux qui dépassent souvent les 42 heures par semaine. Microsoft a même identifié une nouvelle structure temporelle : la « journée à trois pics« – matin, après-midi, puis un dernier regain de productivité… avant le coucher.
Photo CDX – Unsplash
Si le travail flexible peut offrir une meilleure articulation entre vie pro et vie perso, il n’est pas sans conséquences sur la santé. Les travaux sur les horaires décalés sont clairs : troubles du sommeil, déséquilibres métaboliques, hausse des accidents… Et même un risque accru de certains cancers, notamment chez les femmes ayant travaillé de nuit plusieurs années (+19 % de risque de cancer du sein).
Une société en voie de désynchronisation ?
Au-delà des impacts individuels, le travail flexible interroge notre organisation collective. Nos sociétés reposent sur une synchronisation des temps : horaires scolaires, services publics, commerces, événements… Qu’advient-il lorsque chacun module son emploi du temps à sa convenance ?
La popularisation de la « tracance« – contraction de « travail » et « vacances » – illustre bien cette désynchronisation. Travailler depuis son lieu de villégiature, hors du temps collectif, devient une nouvelle norme pour certains.
Photo Reka Ilyes – Unsplash
Le précédent du travail du dimanche
Le débat n’est pas nouveau. Il avait déjà émergé avec le travail du dimanche, opposant les partisans de la liberté individuelle aux défenseurs d’un temps de repos commun. Si 82 % des Français restent attachés au repos dominical (source : Capital Social), 45 % des 18-24 ans se disent prêts à travailler ce jour-là.
Pourtant, une étude de l’INSEE démontre que les personnes travaillant le dimanche souffrent d’une perte de sociabilité, d’un temps de loisir réduit, et que le repos compensateur ne suffit pas à compenser cette désynchronisation.
Au final, ce qui doit être une avancée pour la liberté de chacun pourrait se transformer en facteur de fragmentation sociale. Si certains choisissent librement leurs horaires, d’autres subissent des contraintes invisibles : surcharge, isolement, perte de repères.
Le travail flexible n’est pas une tendance passagère. Il redéfinit notre rapport au temps, au collectif, à la santé et à la société. Mais pour qu’il reste un progrès, il doit être pensé comme un cadre collectif et non comme une simple individualisation.
Le défi des prochaines années ? Faire du travail flexible un outil de bien-être social et d’équité, et non un nouveau facteur de division.
Cet article est une reprise d’une de nos meilleures newsletters.
Pour recevoir les prochaines éditions de Work & the City, abonnez-vous ici !